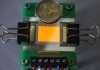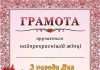Alors que la plupart des créatures que nous imaginons comme intelligentes – les chiens, les dauphins, les corbeaux – ont un cerveau, certains animaux marins prospèrent entièrement sans eux. Les méduses, les étoiles de mer, les oursins et les anémones ne possèdent pas les groupes nerveux centralisés que nous appelons cerveaux. Pourtant, ils démontrent des capacités remarquables à capturer des proies, à échapper au danger et à réagir intelligemment à leur monde. Alors, est-ce que ces créatures sans cervelle « pensent » réellement ?
Cette question suscite un débat fascinant parmi les scientifiques sur ce qui constitue en premier lieu la pensée. Il s’avère que même sans cerveau centralisé, de nombreux animaux possèdent un système nerveux complexe, capable de comportements complexes.
Au lieu de cerveaux, les méduses, les anémones de mer et les animaux apparentés possèdent des réseaux nerveux diffus. Il s’agit essentiellement de réseaux interconnectés de neurones répartis dans tout leur corps, concentrés le long de tentacules. Ce réseau décentralisé permet à ces créatures de traiter les informations sensorielles et de déclencher des réponses coordonnées comme nager, piquer, se nourrir et se contracter. Considérez-le comme un système de capteurs et de réponse à l’échelle de l’organisme plutôt que comme un centre de commande centralisé.
Étonnamment, cette configuration simple prend en charge un apprentissage sophistiqué. Les chercheurs ont démontré que l’anémone de mer starlette peut former des mémoires associatives. Ils ont entraîné ces anémones à associer un éclair lumineux inoffensif à un léger choc électrique. Finalement, seule la lumière les a fait se rétracter – une indication claire d’une association apprise. Une autre étude a révélé que les anémones peuvent même reconnaître des voisins génétiquement identiques après des interactions répétées, modérant ainsi leur comportement territorial agressif envers les « parents ». Cela suggère une capacité à distinguer le soi du non-soi.
Une autre preuve vient des méduses-boîtes. Des expériences ont montré qu’ils pouvaient associer des repères visuels à des sensations physiques comme se heurter à des objets, améliorant ainsi leurs compétences de navigation autour des obstacles. Certains scientifiques affirment même que l’apprentissage peut se produire au niveau des neurones individuels !
Alors, si ces créatures font preuve d’apprentissage et de mémoire – des caractéristiques souvent associées à la pensée – devrions-nous les considérer comme des penseurs ? Cette question nous plonge en territoire philosophique car la « pensée » elle-même manque d’une définition universellement acceptée. Les scientifiques ont tendance à privilégier le terme « cognition », qui englobe des capacités plus larges de traitement de l’information, comme la reconnaissance de modèles, la prise de décisions et la formation de souvenirs.
Si la cognition est définie au sens large comme tout changement de comportement qui va au-delà des réflexes de base, alors les animaux sans cervelle en présentent définitivement. Cependant, les capacités cognitives plus complexes, potentiellement liées à la conscience ou à la conscience de soi, restent une question ouverte.
Le fait même que ces animaux aient prospéré pendant des centaines de millions d’années sans cerveau alors que d’innombrables espèces dotées d’un cerveau ont disparu suggère que leur système nerveux décentralisé est remarquablement efficace pour s’adapter aux environnements changeants. Peut-être que la « pensée » peut se manifester sous diverses formes au-delà de notre compréhension centrée sur l’humain.